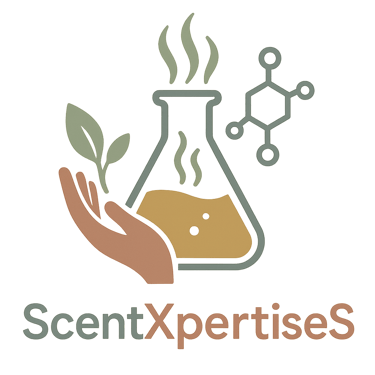Toxicité des huiles essentielles : l’illusion du naturel, le défi de la qualité
Bien que naturelles, les huiles essentielles peuvent présenter une toxicité élevée selon leur composition chimique. Certaines sont même réservées à la vente en pharmacie. Cet article examine les dangers associés à certaines familles moléculaires, les limites des contrôles de qualité en officine, et le rôle – parfois théorique – des pharmaciens dans la vérification des certificats d’analyse. Il fait également le point sur les référentiels officiels (pharmacopée, normes AFNOR, ISO) censés encadrer la qualité des HE, tout en montrant leurs lacunes actuelles.
Esméralda Cicchetti
7/7/20254 min temps de lecture


Toxicité des huiles essentielles : l’illusion du naturel, le défi de la qualité
Les huiles essentielles (HE), bien que d’origine naturelle, ne sont pas dénuées de risques. Nous avons déjà partiellement abordé le sujet en insistant sur l'intérêt de la connaissance des chémotypes (voir article blog).
Leur composition complexe et leur concentration en substances actives les rapprochent davantage du médicament que du simple produit naturel. Pourtant, leur image reste souvent associée à la douceur, au bien-être… voire à l’innocuité. Cette représentation est dangereuse.
L’usage des HE, notamment en automédication, mérite un éclairage scientifique et réglementaire, car certaines peuvent être toxiques, voire interdites à la vente en dehors du circuit pharmaceutique.
Certaines huiles essentielles sont réglementées comme des substances potentiellement toxiques
Selon l’article D.4211-13 du Code de la santé publique, 15 huiles essentielles ne peuvent être vendues que par un pharmacien. Elles sont reconnues pour leur toxicité élevée : neurotoxicité, phototoxicité, effets irritants ou cancérogènes.
Mais cette liste ne signifie en rien que les autres HE seraient sans danger. Leur toxicité dépend de leur composition moléculaire, de leur dose, de la voie d’administration… et de la vulnérabilité de la personne exposée.
Cas emblématique : les suppositoires aux dérivés terpéniques
En 2011, l’AFSAPS (devenue ANSM) a lancé une alerte aux professionnels de santé : les suppositoires contenant des dérivés terpéniques – composants majeurs des HE – sont contre-indiqués chez les enfants de moins de 30 mois et chez ceux ayant des antécédents de convulsions ou d’épilepsie.
Motif : un risque documenté de convulsions provoquées par ces composés. Ce cas illustre bien que les molécules naturelles n’en sont pas moins pharmacologiquement actives, et donc potentiellement dangereuses en l’absence de précautions.
La toxicité est liée à la composition chimique
Les HE sont des mélanges complexes issus de différentes familles chimiques (monoterpènes, phénols, cétones, esters, lactones…). Certaines familles sont thérapeutiquement puissantes, mais présentent également des profils de risque bien connus :
Phénols (ex. thymol, carvacrol) : puissants antimicrobiens, mais irritants et hépatotoxiques à dose élevée
Cétones (ex. camphre, thuyone) : mucolytiques, mais neurotoxiques et abortifs potentiels
Furocoumarines (dans les agrumes) : phototoxiques en application cutanée
Ces risques sont listés dans les annexes de plusieurs travaux scientifiques et référentiels réglementaires (AFNOR, ISO, ANSM…).
La qualité : un enjeu de sécurité, pas seulement une question marketing
La connaissance précise de la composition chimique d’une HE est donc essentielle pour évaluer sa sécurité d’emploi. Cette exigence concerne au premier chef les professionnels de santé, notamment les pharmaciens, qui sont garants de la qualité des substances utilisées en officine ou à l’hôpital.
En théorie, le pharmacien :
Réceptionne un certificat d’analyse (COA) de chaque lot d’HE,
Vérifie sa conformité aux normes en vigueur (pharmacopée, AFNOR, ISO),
Évalue la présence d’allergènes, de solvants, de contaminants (pesticides, métaux lourds, etc.).
En pratique, selon Michel Faucon, ces critères sont « souvent purement déclaratifs » et reposent sur une confiance excessive dans les laboratoires fournisseurs. Le certificat est rarement demandé en officine, encore moins analysé.
Pharmacopée et normes : une couverture encore incomplète
La pharmacopée européenne, dans sa 11ᵉ édition, définit les critères analytiques pour à peine une trentaine d’huiles essentielles. Cela reste très limité au regard des centaines d’HE utilisées en aromathérapie.
Ces monographies incluent :
Une analyse organoleptique (odeur, aspect, couleur),
Des tests physico-chimiques (densité, indice de réfraction, pouvoir rotatoire),
Des analyses chromatographiques (GC-MS, HPLC) pour l’identification des constituants actifs et des impuretés (organiques, inorganiques, microbiologiques).
Mais faute d’une couverture exhaustive, les professionnels doivent souvent se tourner vers d’autres référentiels :
Les normes AFNOR (T75 A) pour la France,
Les normes ISO (TC 54) au niveau international.
Ces documents définissent des profils chimiques de référence pour chaque HE, afin de détecter les anomalies, les adultérations et les contrefaçons.
Nous discuterons dans un prochain article si les contrôles préconisés dans ces différents référentiels sont réellement efficaces et suffisants pour assurer la sécurité des consommateurs qui, pour rappel, ne sont pas aidés par l'étiquetage des HE qu'ils achètent (voir article blog) .
Conclusion : une naturalité à encadrer strictement
Loin des discours simplificateurs, la toxicité potentielle des huiles essentielles est réelle, documentée et surtout évitable — à condition que les professionnels s’attachent à en vérifier la composition exacte et la conformité réglementaire.
Mais cette exigence suppose :
Une formation adaptée,
Une vigilance accrue,
Et un accès systématique aux analyses de qualité.
La rigueur scientifique ne doit pas être un luxe, mais une exigence de base pour garantir la sécurité de l’usage thérapeutique des huiles essentielles.
Une question, un besoin analytique en lien avec les huiles essentielles? Contactez-nous!
Références
Code de la santé publique. Listes des huiles essentielles au monopole pharmaceutique. Légifrance. [En ligne] 2007. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190583.
AFSAPS. Lettre aux professionnels de santé. ANSM. [En ligne] 2011. https://ansm.sante.fr/uploads/2020/11/04/20201104-lp-111114-terpenes.pdf.
ANSM. Pharmacopée française: préambule. ANSM. [En ligne] 23 10 2020. https://ansm.sante.fr/page/phramacopee-francaise-preambule.
© 2025. Tous droits réservés

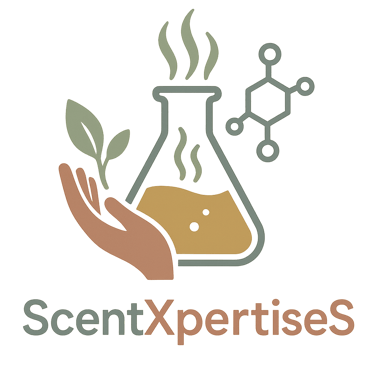
contact@scentxpertises.com
RCS Grasse 944 323 849
Société enregistrée au Registre National des Editeurs de Livres. Indicatif éditeur: 978-2-488641