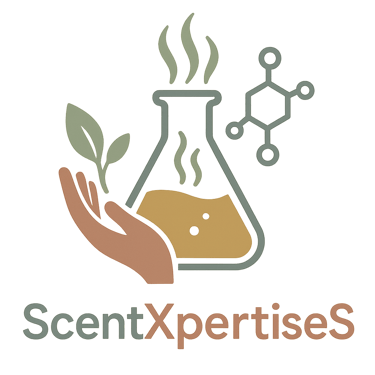L'analyse des huiles essentielles et la vérification du chémotype : Sécurité et aspect thérapeutique
Le chémotype d’une huile essentielle désigne sa composition chimique spécifique, qui peut varier au sein d’une même espèce botanique selon l’origine géographique, les conditions de culture ou la méthode d’extraction. Ce profil chimique détermine ses propriétés thérapeutiques, son efficacité et sa sécurité d’utilisation. Ignorer le chémotype expose à des erreurs d’usage, parfois graves. L’article explore les enjeux de cette notion, les implications en phytovigilance, et les méthodes analytiques de référence (GC, MS) nécessaires pour garantir la qualité et prévenir les risques. Un incontournable pour une aromathérapie sûre et maîtrisée
Esméralda Cicchetti
5/10/20256 min temps de lecture


Qu'est-ce que le chémotype ?
Le chémotype désigne la variation chimique qui existe au sein d'une même espèce de plante, en fonction des conditions environnementales, de la région de culture et des méthodes d'extraction utilisées. En d'autres termes, le chémotype est le profil chimique spécifique d'une huile essentielle, qui peut varier considérablement même entre des spécimens de la même espèce botanique.
Il est primordial de comprendre le concept de chémotype lorsque l'on s’intéresse à l'aromathérapie et à l'utilisation des huiles essentielles. En effet, les propriétés thérapeutiques d'une huile essentielle peuvent être profondément influencées par sa composition chimique. Ainsi, connaître le chémotype d'une huile permet de choisir celle qui correspond le mieux à un besoin particulier, garantissant ainsi une utilisation sécuritaire et efficace.
EXEMPLES DE CHEMOTYPES: l'huile essentielle de thym
Pour illustrer l'intérêt de connaître le chémotype d'une huile essentielle, l'exemple du thym est assez intéressant.
On va parler de Thym à "xxx" avec xxx=molécule principale/marqueur de l'huile essentielle.
Ainsi, nous pourrons distinguer notamment le thym à:
thymol: antiinfectieux, antalgique
bornéol: tonique, antalgique;
linalol: antibactérien doux, tonique;
géraniol: antibactérien, antifongique, antiviral;
thuyanol: antobactérien, antifongique, antiviral, réchauffant, régénérateur hépatique
eucalyptol (ou 1,8-cinéole): expectorant, antibactérien, antifongique, antiviral
Au-delà des différences thérapeutiques, la notion de chémotype aura également un impact sur la sécurité d'utilisation des huiles essentielles.
PHYTOvigilance et chemotype
La sécurité des huiles essentielles est une préoccupation majeure pour les utilisateurs, que ce soit dans les domaines de l'aromathérapie ou de la cosmétologie. Chaque huile essentielle possède un chémotype unique, qui détermine non seulement ses propriétés thérapeutiques, mais aussi son profil de sécurité. Il est impératif d'évaluer ces propriétés avant l'utilisation pour éviter des effets indésirables potentiels.
La phytovigilance désigne la surveillance des effets indésirables et interactions liés à l’usage de plantes médicinales, qu’elles soient utilisées en médicaments, compléments, cosmétiques ou autres formes. Elle regroupe pharmacovigilance, nutrivigilance, cosmétovigilance, addictovigilance et toxicovigilance, et constitue une obligation légale en Europe.
Les risques associés à l'utilisation inappropriée d'huiles essentielles sont réels et peuvent inclure des irritations cutanées, des réactions allergiques, et même des neurotoxicités dans le cas de certains composés. Les autorités sanitaires (ANSM/Centre régional de pharmacovigilance (CRPV)/ Agence Européenne du médicament (EMA),ANSES, Commission Européenne via Portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) jouent un rôle crucial dans l'évaluation sanitaire, la vigilance, et la réglementation de ces produits. Elles établissent des lignes directrices et des normes de sécurité pour garantir que les huiles essentielles disponibles sur le marché soient sûres pour les consommateurs.
Selon le type d'usage de l'huile essentielle, le nom de la vigilance et l'organisme dédié, changent:
Pharmacovigilance: Médicaments à base de plantes, phyto-aromathérapie
Phytovigilance: Médicaments à base de plantes
Nutrivigilance: Compléments alimentaires à base d’extraits dont les HE
Cosmétovigilance Produits cosmétiques contenant des plantes et des extraits dont les HE
Addictovigilance Plantes ou extraits de plantes dont HE psychoactives, toxicomanogène
Toxicovigilance Exposition accidentelle ou abusive à des plantes et des extraits dont les HE, plantes et extraits toxiques
Le cas du romarin est intéressant pour illustrer la problématique de phytovigilance liée à la méconnaissance du chémotypes.
Ainsi le romarin (Rosmarinus officinalis) à camphre est épileptogène, et toxique pour le foie alors que le chémothype à verbénone est au contraire hépatoprotecteur!
Méthodes d'analyse du chemotype des huiles essentielles
L’analyse du chémotype des huiles essentielles est un processus fondamental pour garantir leur qualité et leur efficacité thérapeutique. De plus, sa vérification a une importance cruciale dans les domaines de la réglementation des parfums, produits aromatiques et produits pharmaceutiques. Les normes de qualité et de sécurité (AFNOR, pharmacopées,...) exigent que les utilisateurs soient informés des différences qui peuvent exister entre les chémotypes.
Parmi les méthodes d'analyse utilisées pour définir les chémotypes, la chromatographie en phase gazeuse (GC) et la spectroscopie de masse (MS) se distinguent par leur précision et leur capacité à identifier divers composants chimiques. La chromatographie en phase gazeuse est une technique qui permet de séparer les constituants d'un mélange volatil, offrant ainsi une visualisation claire de la composition d'une huile essentielle.
Parallèlement, la spectroscopie de masse fournit des informations complémentaires cruciales nécessaires à l'identification. En corrélant les données obtenues par la GC et la MS, il est possible de dresser un profil chimique exhaustif des huiles essentielles, facilitant ainsi la vérification de leur chémotype. Cela est essentiel pour assurer l'authenticité des produits et pour prévenir la présence de contaminants ou de composés indésirables qui pourraient affecter leur usage thérapeutique. Les analyses classiquement proposées avec le détecteur à ionisation de flamme (FID) sont quant à elles insuffisantes pour assurer l'identité des composés en présence dans le mélange.
Conclusion et recommandations
En résumé, l'analyse des huiles essentielles et la vérification du chémotype se révèlent être des éléments cruciaux pour garantir la sécurité et l'efficacité thérapeutique. Les huiles essentielles, bien que naturelles, peuvent présenter des risques potentiels si elles ne sont pas correctement analysées. La différenciation des chémotypes permet non seulement de déterminer les propriétés spécifiques des huiles, mais également d'atténuer les effets indésirables associés à une mauvaise utilisation ou à une qualité inférieure des produits. Cela souligne l'importance d'une approche rigoureuse lors de la sélection et de l'utilisation des huiles essentielles.
Pour les praticiens, il est recommandé d'intégrer des méthodes d'analyse scientifique pour confirmer l'identité et la qualité des huiles essentielles avant leur utilisation dans des traitements. Cela implique de vérifier systématiquement les résultats des analyses de chémotypes et de se fier à des sources fiables et reconnues pour l'acquisition de leurs produits. Par ailleurs, une formation continue sur les évolutions récentes des connaissances en aromathérapie et toxicologie est conseillée pour maintenir un niveau de sécurité optimal.
Les utilisateurs, quant à eux, doivent être encouragés à consulter un professionnel de santé avant de se lancer dans l'utilisation des huiles essentielles, en particulier celles qui possèdent des propriétés puissantes ou des contre-indications. Il est conseillé de pratiquer des tests cutanés pour vérifier les allergies et de respecter les dosages recommandés. L’étiquetage clair et la documentation des huiles essentielles utilisées peuvent également favoriser une utilisation sécuritaire.
En définitive, une approche informée et prudente dans l'utilisation des huiles essentielles, souspindée par une vérification adéquate du chémotype, constitue la clé pour maximiser les bienfaits tout en réduisant les risques associés à leur utilisation.
Une question, un besoin analytique en lien avec les huiles essentielles? Contactez-nous!
reFERENCES
Couic Marinier. Le guide terre vivante des huiles essentielles. Mens: Editions Terre Vivante, 2017
Faucon, Michel. Traité d'aromathérapie scientifique et médicale - Les huiles essentielles. 3ème édition. Paris : Editions Sang de la Terre, 2019.
Baudoux, D., Blanchard, J.M. et malotaux, A.F. Les cahiers pratiques d'aromathérapie selon l'école française. Volume 4 - Soins palliatifs. Luxembourg : Editions Inspir S.A., 2010.
Franchomme, P., Jollois, R. et Pénoël, D. L'aromathérapie exactement. s.l. : Editions Roger Jollois, 2001.
Huiles essentielles : à utiliser avec précaution! ANSES. 2024, Vigil'Anses - Le bulletin des vigilances, p. 6.
H. Lehmann, , J.-Y. Pabst. La phytovigilance : impératif médical etobligation légale. Annales Pharmaceutiques Françaises. 74, 2016, Vol. 1, 49-60.
ANSM. Bonnes pratiques de pharmacovigilance. ANSM. [En ligne] 02 06 2022. https://ansm.sante.fr/documents/reference/bonnes-pratiques-de-pharmacovigilance.
Médicaments à base de plantes et huiles essentielles. ANSM. [En ligne] 2020. https://ansm.sante.fr/qui-sommes-nous/notre-perimetre/les-medicaments/p/medicaments-a-base-de-plantes-et-huiles-essentielles#title.
ANSES. Le dispositif national de toxicovigilance. ANSES. [En ligne] 11 12 2024. https://www.anses.fr/fr/content/le-dispositif-national-de-toxicovigilance.
Cosmétovigilance et tatouvigilance. ANSES. [En ligne] 29 12 2023. https://www.anses.fr/fr/content/cosmetovigilance-et-tatouvigilance#:~:text=La%20cosm%C3%A9tovigilance%20repose%20sur%20la,l%27analyse%20de%20ces%20signalements..
AFSAPS. Recommandations relatives aux critères de qualité des huiles essentielles - Contribution pour l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques contenant des huiles essentielles. ANSM. [En ligne] 21 05 2008. https://ansm.sante.fr/uploads/2020/11/04/20201104-reco-criteres-qualite-huiles-essentielles.pdf.
DGCCRF. Les huiles essentielles. DGCCRF. [En ligne] 15 12 2003. https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/les-fiches-pratiques/les-huiles-essentielles-0.
Code de la santé publique. Listes des huiles essentielles au monopole pharmaceutique. Légifrance. [En ligne] 2007. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006190583.
AFSAPS. Lettre aux professionnels de santé. ANSM. [En ligne] 2011. https://ansm.sante.fr/uploads/2020/11/04/20201104-lp-111114-terpenes.pdf.
© 2025. Tous droits réservés

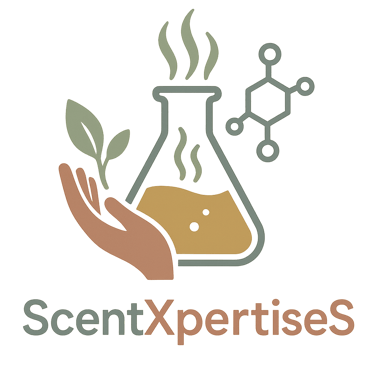
contact@scentxpertises.com
RCS Grasse 944 323 849
Société enregistrée au Registre National des Editeurs de Livres. Indicatif éditeur: 978-2-488641